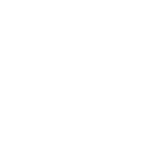Le PACS ne confère aucun droit automatique d’héritage entre partenaires. Sans testament, le partenaire survivant n’a aucune part dans la succession, contrairement au mariage. Cette situation mérite une attention particulière pour assurer la protection du conjoint pacsé. La rédaction d’un testament reste indispensable, même si les partenaires pacsés bénéficient d’une exonération totale des droits de succession depuis 2007.
Découvrez les règles successorales spécifiques au PACS et les solutions pour protéger votre partenaire.
Qu’est-ce qu’un PACS et comment affecte t-il l’héritage ?
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures pour organiser leur vie commune. Créé en 1999, ce statut offre un cadre légal alternatif au mariage.
Point fondamental à comprendre, le partenaire pacsé n’est pas considéré comme héritier légal. Sans testament, il ne peut prétendre à aucune part de l’héritage de son partenaire décédé, contrairement aux époux mariés.
La loi accorde uniquement au partenaire survivant un droit temporaire d’occupation du logement commun pendant un an après le décès. Pour sécuriser la transmission du patrimoine, les partenaires pacsés doivent prendre des dispositions spécifiques de leur vivant.
La différence entre PACS et mariage en matière de succession
La distinction fondamentale réside dans le statut d’héritier : le conjoint marié bénéficie automatiquement d’une part de la succession, ce qui n’existe pas dans le PACS. Un époux peut notamment choisir entre l’usufruit total ou le quart en pleine propriété des biens du défunt.
Le mariage garantit aussi une pension de réversion au survivant, un avantage absent du PACS. Cette protection s’étend à la résidence principale avec un droit viager au logement pour l’époux survivant.
Les couples mariés profitent d’une quotité disponible spéciale, permettant de léguer davantage au conjoint. Pour les partenaires pacsés, la transmission du patrimoine reste limitée à la quotité disponible standard, même en l’absence d’héritiers réservataires.
Les règles de succession pour les partenaires pacsés
Absence de testament : quels droits pour le partenaire survivant ?
Le partenaire pacsé survivant conserve uniquement ses biens personnels et sa part des biens détenus en indivision. La loi lui accorde aussi le droit de récupérer le capital décès versé par la sécurité sociale sous certaines conditions.
Un autre droit méconnu concerne le transfert automatique du bail locatif lorsque les partenaires étaient cotitulaires. Cette protection s’applique sans condition de durée du PACS.
Le partenaire survivant peut également demander l’attribution préférentielle de certains biens meubles garnissant le logement, à condition d’en payer la valeur aux héritiers légaux. Cette demande doit être formulée dans un délai d’un mois suivant le décès.
La place du partenaire pacsé dans l’ordre successoral légal
Dans la hiérarchie des héritiers établie par le Code civil français, le partenaire pacsé ne figure pas parmi les successibles. La loi privilégie d’abord les descendants directs, puis les ascendants et les collatéraux privilégiés.
Cette absence de reconnaissance légale place le partenaire pacsé au même rang qu’un étranger à la famille. Les biens du défunt sont automatiquement transmis aux héritiers réservataires : enfants, parents ou frères et sœurs selon les situations.
La réserve héréditaire reste intouchable, même avec une convention de PACS. Un exemple concret : si une personne pacsée décède en laissant deux enfants, ces derniers se partageront l’intégralité du patrimoine, sauf disposition testamentaire spécifique sur la quotité disponible.
Succession avec enfants et sans enfants : quelles différences ?
Les droits du partenaire pacsé varient radicalement selon la présence d’enfants. Sans descendance, le partenaire peut recevoir par testament l’intégralité du patrimoine. Un exemple concret : sur un patrimoine de 300 000 €, le partenaire survivant peut tout hériter.
La situation change en présence d’enfants. Un seul enfant laisse une quotité disponible de 50% au partenaire. Avec deux enfants, elle passe à 33%, puis à 25% pour trois enfants ou plus. Prenons un cas pratique : sur un patrimoine de 400 000 €, le partenaire pourra recevoir 200 000 € maximum avec un enfant, mais seulement 100 000 € avec trois enfants.
Les ascendants du défunt conservent un droit de retour sur les biens qu’ils ont donnés, dans la limite d’un quart chacun.
La création d’un testament : protection supplémentaire pour le partenaire
L’importance du testament dans la succession pour les pacsés
Le testament représente un outil juridique indispensable pour protéger son compagnon de vie. Cette protection s’avère particulièrement utile pour la transmission du logement familial et des biens mobiliers.
La rédaction d’un testament authentique devant notaire garantit une sécurité maximale. Cette forme offre l’avantage d’un conseil personnalisé et réduit les risques de contestation future.
Les couples pacsés bénéficient d’une exonération totale des droits de succession sur les biens légués, à condition que le testament soit valablement rédigé. Un avantage fiscal non négligeable qui permet de transmettre son patrimoine sans charge fiscale pour le survivant.
Comment rédiger un testament pour son partenaire de PACS ?
La rédaction manuscrite du testament requiert une précision absolue dans le choix des mots. Mentionnez vos nom, prénom, date et lieu de naissance, puis identifiez clairement votre partenaire pacsé comme bénéficiaire avec ses coordonnées complètes.
Un modèle simple commence par “Ceci est mon testament” et se termine par votre signature. La formule “Je lègue à [nom complet du partenaire]” doit détailler explicitement les biens concernés.
Deux options s’offrent à vous : le testament olographe, entièrement écrit à la main, daté et signé, ou la version notariée qui garantit sa conservation au fichier central des dernières volontés. Dans les deux cas, évitez les ratures et utilisez un langage simple, sans ambiguïté sur vos souhaits.
Les limites testamentaires imposées par la loi
La réserve héréditaire constitue la principale contrainte légale pour les partenaires pacsés. Un testament ne peut jamais porter atteinte à cette part minimale garantie aux héritiers directs.
Les partenaires pacsés font face à une autre restriction majeure : l’impossibilité d’inclure des dispositions testamentaires dans leur convention de PACS. Cette clause serait automatiquement frappée de nullité.
Le droit de retour légal des ascendants représente une limite supplémentaire. Les parents du défunt peuvent récupérer les biens qu’ils ont donnés à leur enfant, même si un testament les attribuait au partenaire survivant.
La transmission du logement familial reste particulièrement encadrée. Un partenaire pacsé ne peut recevoir par testament que la quotité disponible de ce bien, le reste revenant obligatoirement aux héritiers réservataires.
Le logement en cas de décès d’un partenaire de PACS
En cas de location : les droits sur le bail du partenaire survivant
Le partenaire pacsé survivant bénéficie d’une protection automatique sur le bail locatif. Cette garantie s’applique dans deux situations : lorsque les deux partenaires étaient cotitulaires du bail ou quand ils avaient demandé conjointement au propriétaire d’en être cotitulaires.
Même si le défunt était seul titulaire du bail, le partenaire survivant obtient le transfert du contrat de location à son nom. Les loyers de la première année suivant le décès sont remboursés par la succession.
Un point mérite attention : d’autres proches comme les descendants peuvent réclamer l’attribution du bail. Dans cette situation, le juge des contentieux de la protection tranchera selon les circonstances particulières de chaque dossier.
En cas de propriété : le devenir de la résidence principale
Lorsque la résidence principale appartenait uniquement au partenaire décédé, le survivant ne dispose d’aucun droit de propriété automatique. La jouissance gratuite du logement pendant un an représente sa seule garantie légale.
Pour les biens acquis en indivision, le partenaire survivant conserve sa part de 50% mais se retrouve en copropriété avec les héritiers du défunt pour l’autre moitié. Cette situation peut nécessiter un rachat de parts ou une vente du bien.
Un testament peut prévoir l’attribution préférentielle du logement au survivant, permettant son maintien dans les lieux moyennant une compensation financière aux héritiers réservataires.
Les solutions pour sécuriser le droit au logement
La convention de Pacs aménagée constitue une première solution efficace. En optant pour le régime de l’indivision, chaque acquisition immobilière devient automatiquement commune aux deux partenaires.
L’achat en tontine représente une alternative intéressante : au décès d’un partenaire, le survivant devient propriétaire unique du bien sans passer par la succession. Cette clause peut s’appliquer à l’achat du logement principal ou d’une résidence secondaire.
La mise en place d’une SCI familiale permet aussi de sécuriser le logement. Les statuts peuvent prévoir un usufruit successif au profit du partenaire survivant, garantissant son maintien dans les lieux à long terme.
Fiscalité et PACS : avantages et inconvénients
Imposition et héritage : ce que les pacsés doivent savoir
Les partenaires pacsés bénéficient d’une exonération totale des droits de succession, à condition que leur union soit toujours valide au moment du décès. Cette mesure fiscale avantageuse s’applique sans limite de montant sur l’ensemble du patrimoine transmis.
Cette exonération peut être combinée avec d’autres mécanismes fiscaux. Par exemple, un partenaire pacsé peut recevoir un bien immobilier par testament tout en profitant des abattements sur les donations du vivant, fixés à 80 724 euros tous les 15 ans.
La transmission d’un compte bancaire ou d’un portefeuille d’actions suit la même logique fiscale. Une valorisation précise de ces actifs financiers reste néanmoins nécessaire pour la déclaration de succession, même en l’absence d’imposition.
Les droits de succession entre partenaires pacsés
Le partenaire pacsé survivant bénéficie d’une protection fiscale avantageuse lors de la transmission du patrimoine. Cette disposition s’applique à l’ensemble des biens : comptes bancaires, immobilier, valeurs mobilières ou objets précieux.
Un point essentiel à noter : le statut fiscal privilégié reste valable uniquement si le PACS n’a pas été dissous avant le décès. Dans le cas d’une rupture, le survivant perdrait ces avantages et serait considéré comme un simple tiers.
La transmission peut s’effectuer par testament ou donation, avec une liberté totale sur le choix des biens légués. Cette souplesse permet d’organiser la transmission patrimoniale selon les souhaits du couple, tout en respectant les règles de la réserve héréditaire.
Comparaison de la fiscalité entre PACS, mariage et concubinage
La disparité fiscale entre les trois modes d’union se révèle particulièrement marquée. Le mariage et le PACS présentent des avantages similaires avec une imposition commune des revenus, réduisant souvent le montant total à payer grâce au mécanisme du quotient familial.
Les concubins, quant à eux, restent deux contribuables distincts, chacun devant remplir sa propre déclaration. Cette situation peut augmenter significativement leur charge fiscale, notamment lorsque leurs revenus sont déséquilibrés.
Par exemple, pour un couple avec des revenus annuels de 30 000 € et 60 000 €, l’imposition commune en cas de mariage ou de PACS peut générer une économie moyenne de 2 000 € par an par rapport au concubinage.
Les démarches à suivre en cas de décès du partenaire
Les premières étapes après le décès du partenaire pacsé
La première action consiste à faire établir un certificat de décès par un médecin, document indispensable pour toutes les démarches administratives. Dans les 24 heures suivantes, contactez une entreprise de pompes funèbres qui organisera la cérémonie selon les souhaits exprimés.
Prévenez rapidement la mairie du lieu de résidence pour enregistrer le décès. Un acte sera délivré, permettant d’informer les différentes administrations. N’oubliez pas de joindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sous 30 jours pour demander le versement du capital décès.
Prenez rendez-vous avec un notaire dans les semaines qui suivent. Ce professionnel du droit vous accompagnera dans l’inventaire des biens et vérifiera l’existence éventuelle d’un testament.
La déclaration de succession pour les partenaires pacsés
Le partenaire pacsé survivant dispose d’un délai de 6 mois pour soumettre sa déclaration de succession auprès du service des impôts. Ce délai s’étend à 12 mois si le décès survient à l’étranger.
La déclaration doit répertorier l’ensemble du patrimoine au jour du décès : comptes bancaires, biens immobiliers, véhicules, bijoux et objets de valeur. Un inventaire détaillé s’avère indispensable pour établir l’actif successoral net.
Le partenaire pacsé bénéficie d’une exonération totale des droits de succession sur les biens reçus par testament. Cette exonération s’applique sans plafond, contrairement aux donations entre vifs limitées à 80 724 euros tous les 15 ans.
Les organismes à contacter et les documents nécessaires
La Caisse d’Allocations Familiales doit recevoir un acte de décès et le relevé d’identité bancaire du partenaire survivant pour réévaluer les prestations sociales. Un courrier recommandé à l’employeur, accompagné du certificat de décès, permettra d’obtenir le solde de tout compte.
Pensez à notifier la banque avec l’acte de décès et votre pièce d’identité. Pour les contrats d’assurance, munissez-vous du RIB et des justificatifs de vie commune lors de vos démarches auprès des compagnies.
La mairie transmettra automatiquement l’information aux services fiscaux. Vous devrez néanmoins leur adresser une copie du livret de famille ou de la convention de PACS pour régulariser la situation fiscale du foyer.
Les aides et protections supplémentaires
La pension de réversion et le PACS : ce qu’il faut savoir
À ce jour, les partenaires pacsés n’ont pas accès à la pension de réversion. Cette prestation reste exclusivement réservée aux couples mariés. Un exemple concret : si votre partenaire de PACS décède, vous ne pourrez pas percevoir une partie de sa retraite, contrairement à un conjoint marié qui peut recevoir jusqu’à 54% de la pension du défunt.
La question fait débat et le Conseil d’orientation des retraites examine actuellement une possible extension aux couples pacsés. Cette réforme pourrait aboutir dès 2026, avec une condition de durée minimale du PACS fixée à 5 ans.
En attendant, les partenaires pacsés doivent anticiper cette absence de protection par d’autres moyens, comme la souscription d’une assurance décès ou la mise en place d’une épargne dédiée.
Assurance-vie et pacs : comment protéger son partenaire ?
L’assurance-vie constitue un excellent moyen de sécuriser l’avenir financier de votre partenaire pacsé. La clause bénéficiaire permet de lui transmettre un capital hors succession, dans la limite de 152 500 € sans fiscalité pour les versements effectués avant 70 ans.
Un point essentiel : la désignation du bénéficiaire doit être claire et précise. Préférez la formule “mon partenaire de PACS au moment de mon décès” plutôt qu’une simple mention nominative qui deviendrait caduque en cas de rupture.
Pour maximiser cette protection, pensez à répartir votre épargne sur plusieurs contrats. Votre partenaire pourra alors accepter ou renoncer à chaque contrat individuellement selon ses besoins, notamment en présence d’autres héritiers.
Les garanties possibles via les contrats de prévoyance
Les contrats de prévoyance apportent une protection complémentaire essentielle au partenaire pacsé. Ces garanties permettent le versement d’une rente mensuelle ou d’un capital au survivant, assurant une sécurité financière durable.
Avantage : la possibilité de personnaliser les montants selon vos besoins spécifiques. Par exemple, une rente peut être calculée pour couvrir les charges mensuelles du foyer ou maintenir le niveau de vie du partenaire survivant.
La souscription à plusieurs types de garanties renforce la protection globale : une rente éducation pour les enfants, une garantie invalidité ou encore une couverture des frais d’obsèques. Ces options s’adaptent à l’évolution de votre situation familiale et offrent une flexibilité appréciable dans la durée.
Conclusion et récapitulatif des points clés
- Le testament authentique notarié reste l’outil le plus sûr pour transmettre son patrimoine au partenaire pacsé.
- La rédaction d’une convention de Pacs personnalisée permet d’adapter le régime patrimonial aux besoins du couple.
- La désignation du partenaire comme bénéficiaire des contrats d’assurance doit être régulièrement mise à jour.
- L’acquisition de biens en indivision garantit au partenaire survivant de conserver 50% du patrimoine commun.
- Le droit temporaire au logement offre une année de répit au partenaire survivant pour organiser sa situation.
- Un rendez-vous annuel chez le notaire aide à maintenir une stratégie patrimoniale adaptée aux évolutions du couple.
Questions fréquentes sur le PACS et l’héritage
Comment se passe un héritage quand on est pacsé ?
Sans disposition particulière, le survivant du PACS n’a aucun droit sur les biens du défunt. Ces derniers reviennent automatiquement aux héritiers légaux : enfants, parents ou frères et sœurs.
Le survivant conserve uniquement sa part des biens acquis en commun pendant le PACS, comme le mobilier ou un logement acheté ensemble. Pour le logement principal, un droit d’occupation gratuit d’un an lui est accordé.
La solution la plus adaptée reste la rédaction d’un document précisant la répartition souhaitée des biens. Cette démarche permet notamment de transmettre jusqu’à la totalité du patrimoine au survivant en l’absence d’enfants. En présence d’enfants, le legs se limite à la quotité disponible, soit un quart à la moitié des biens selon leur nombre.
Comment donner sa part de maison à son conjoint pacsé ?
La donation d’une part de maison entre partenaires pacsés s’effectue obligatoirement devant notaire. L’acte notarié garantit la sécurité juridique de la transaction et précise les modalités exactes du transfert de propriété.
Un abattement fiscal de 80 724 euros s’applique sur la valeur du bien transmis. Au-delà de ce montant, le partenaire donataire devra s’acquitter de droits de mutation calculés selon un barème progressif.
La donation peut porter sur la totalité ou une fraction de la part détenue. Cette flexibilité permet d’adapter la transmission aux besoins du couple, notamment pour faciliter un projet d’acquisition commun ou anticiper la protection du partenaire survivant.
Quels sont les droits pour un couple pacsé ?
Les partenaires pacsés bénéficient de droits sociaux essentiels au quotidien. La prise en charge des frais de santé s’étend automatiquement au partenaire sans activité professionnelle. Le capital décès de la Sécurité sociale peut également être versé au survivant.
Sur le plan locatif, le partenaire pacsé dispose d’un droit exclusif sur le bail en cas de départ ou de décès du signataire initial. Cette protection s’applique sans condition de durée du PACS.
Le régime fiscal du PACS permet une imposition commune dès l’année de sa conclusion. Les partenaires peuvent aussi se transmettre mutuellement leur droit au bail commercial, facilitant la continuité d’une activité professionnelle.
Le PACS protège-t-il entièrement le partenaire survivant ?
La protection offerte par le PACS reste partielle et temporaire. Le droit d’occupation gratuite du logement pendant un an constitue la seule garantie automatique, à condition d’y résider au moment du décès.
Un exemple révélateur : un partenaire pacsé qui a vécu 20 ans avec le défunt peut se retrouver sans aucun droit sur leur maison commune si celle-ci appartenait exclusivement au défunt. Sans testament, il devra quitter les lieux après la première année.
La sécurité financière n’est pas garantie non plus. L’absence de pension de réversion et de droits successoraux automatiques rend indispensable la mise en place d’une stratégie de protection : testament, assurance-vie, acquisition en indivision. Ces dispositifs permettent de construire une protection sur mesure, adaptée à chaque situation.
Comment la loi protège-t-elle le partenaire de PACS en l’absence de testament ?
La loi accorde au partenaire lié par un PACS certaines garanties minimales. Le Code civil prévoit notamment la jouissance gratuite du logement familial pendant un an après le décès, selon l’article 763. Cette disposition s’applique quel que soit le propriétaire du bien.
Le partenaire conserve également l’usage du mobilier garnissant ce logement. Cette protection s’étend aux meubles d’usage courant, mais exclut les objets de valeur et les biens professionnels.
La convention de PACS permet aussi de choisir le régime de l’indivision. Dans ce cas, les biens acquis pendant l’union appartiennent automatiquement aux deux partenaires à parts égales, assurant une sécurité patrimoniale basique au survivant.
PACS et donation : est-ce une alternative pratique ?
La donation représente une solution concrète pour transmettre son patrimoine entre partenaires pacsés. L’avantage majeur réside dans l’abattement fiscal de 80 724 euros dont bénéficie le partenaire donataire. Cette somme peut être utilisée en une ou plusieurs fois sur une période de 15 ans.
Un point à garder à l’esprit : la donation reste irrévocable, même après une rupture du PACS. Pour sécuriser la transmission, une acquisition en indivision combinée à une donation de la part restante constitue une stratégie pertinente.
La donation peut porter sur des biens immobiliers, mobiliers ou des sommes d’argent. À noter que le régime fiscal avantageux s’applique uniquement si le PACS perdure au moins jusqu’à l’année suivant la donation, sauf en cas de mariage des partenaires.